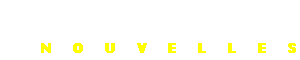 | |
|
Le roi n'est pas mort
par La Presse dans Marc Cassivi, 4 février 2015 |
Article
|
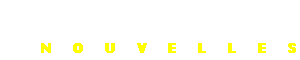 | |
|
Le roi n'est pas mort
par La Presse dans Marc Cassivi, 4 février 2015 |
Article
|
|
Tout a commencé par un rendez-vous manqué. Jean Leloup m'avait convié chez lui, avenue De Lorimier. Je n'avais pas remarqué que son appartement avait la même adresse ou presque que celui de son voisin. J'ai sonné au A, plutôt qu'au B. Ou le contraire. Bref, c'était la mauvaise porte. J'ai sonné et sonné encore, en vain. Pour finir, j'ai rebroussé chemin jusque chez moi, dans le West Island. C'était peut-être un acte manqué. Je me souviens d'avoir été soulagé que Leloup ne soit pas là. J'avais 17 ans. J'étais terrifié à l'idée de réaliser ma toute première entrevue (pour le journal du cégep). Je n'ai pas eu le réflexe de l'appeler d'une cabine téléphonique. C'était en 1990, «avant» l'heure des communications... Je ne me suis rendu compte de ma bévue qu'en soirée. Leloup a été assez gentil pour me recevoir dès le lendemain. Il m'a accueilli chez lui - dans le décor dénudé du vidéoclip de L'amour est sans pitié - pendant plus de deux heures. Il a répondu aux dizaines de questions que j'avais trop préparées, m'a dit qu'il souffrait de troubles bipolaires et de schizophrénie, et nous avons écouté un disque de la Mano Negra. Je venais de rencontrer une idole. À l'adolescence, Jean Leloup m'a réconcilié à lui seul avec le rock and roll québécois. Sa musique a toujours été là, depuis, en toile de fond, ses chansons liées à des événements précis, à des gens, des lieux, des états d'esprit. Je l'ai suivi dans ses multiples métamorphoses. De Jean Leloup à John The Wolf, de Jean Leclerc (son nom de baptême) à Jean Dead Wolf et à Jean Leloup de nouveau, en passant par Massoud Al-Rachid, son pseudonyme d'auteur du conte satirique Noir destin que le mien. En 1986, lorsqu'il incarnait Ziggy dans Starmania, il s'affichait comme Jean Clair, nom qu'il disait avoir adopté «pour le reste de sa carrière». Nous étions pratiquement voisins quand nous nous sommes brouillés, il y a une dizaine d'années, après une entrevue. Il a prétendu avoir été mal cité, dans une lettre ouverte aux médias. Je me suis fâché dans une chronique. Il s'est excusé en direct à la radio de Christiane Charette, accompagné de sa guitare. Je l'ai suivi pas à pas, de Printemps-été à Paradis perdu, du rock and roll au disco (de 1990, remaniée par James Di Salvio), du rap de Johnny Go au country de Mexico. Il m'a un peu perdu dans le brouillon de ses jams de guitare relâchés, et pour de bon avec ses Last Assassins, il y a quelques années. Il avait lui-même l'air perdu à l'époque. Je le croisais dans la rue, hagard. Il se donnait en spectacle en entrevue, tournant tout en dérision sans l'oeil vif des beaux jours. Les vieux démons étaient revenus. Puis Jean Leloup a disparu. De mon quartier, de la vie publique, des écrans radars, sans trop laisser de traces. J'ai cru qu'il avait tué de nouveau son personnage, comme il l'avait fait sur scène en 2003. J'ai craint, comme d'autres, qu'on ne le retrouve plus. Qu'il se soit égaré sur les chemins de traverse. Que les démons ne le lâchent plus. Mais voilà que Leloup est de retour, avec son album le plus inspiré depuis un moment (La vallée des réputations, en ce qui me concerne). À Paradis City, est un disque concis et compact (33 minutes seulement), aux textes forts, à la poésie souvent noire, qui contraste avec des mélodies douces et prégnantes, pour la plupart... enjouées. Pourtant, sur la sombre et mélancolique Retour à la maison, Leloup chante: «Alcoolique ou narcomane, il y a quelqu'un qui rit dans mon cerveau en panne. [...] On m'assure qu'il y a encore de l'espoir, je veux tellement y croire. Mais mon âme est si noire.» Un spleen qui trouve écho dans le livret du CD, où Leloup/Leclerc remercie son frère et ses parents de l'avoir «toujours tenu quand [il] tombait». Le monde est à pleurer. À Paradis City reste malgré ses zones d'ombre un album d'espoir. Et d'ouverture. Jean Leloup a cessé de jouer de la guitare «pour lui» et s'est remis à écrire des chansons «pour nous». Il a d'ailleurs inclus les paroles et les accords de ses chansons dans le livret, pour que l'on chante et gratte la six-cordes avec lui. «Pour ceux qui aiment jouer», précisait-il hier sur sa page Facebook. Ce n'est pas, à mon sens, un détail sans importance. Il y a d'ailleurs moins de guitare électrique sur À Paradis City que sur ses plus récents albums (la plus musclée, Les flamants roses, étant l'exception qui confirme la règle). Leloup sait, et a toujours su, composer des chansons accrocheuses, telle Paradis City, qui renoue avec l'esthétique du Dôme avec un refrain bilingue rappelant Radio Radio. Ce nouvel album, que l'on ne s'y trompe pas, c'est du Jean Leloup classique, sans trop d'esbroufe ni de surprises à l'horizon. (Sinon l'introduction, classique justement, du Roi se meurt, interprétée par un quatuor à cordes.) Le roi n'est pas mort. Il est là, unique, émouvant, lucide, authentique, volontaire. On devrait tous s'en réjouir. PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA. Jean Leloup avait disparu des écrans radars. Le voilà de retour avec son album le plus inspiré depuis un moment. |
|
Cet article contient aussi une image:
[1]
|
|
page principale
| articles: alphabétique
| articles: chronologique
| photos
Dernière mise à jour le
14 février 2015.
|